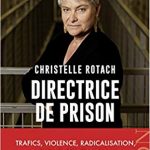 Directrice de prison pendant plus de 20 ans, Christelle Rotach, 50 ans, connaît intimement la réalité pénitentiaire : la surpopulation, la violence, les suicides, la radicalisation. Après avoir dirigé les maisons d’arrêt (Fleury Mérogis, Nanterre, Les Baumettes, La Santé) les plus sensibles de France durant vingt-deux ans, à présent inspectrice générale de la justice, elle publie un témoignage (Directrice de prison. Trafics, violence, radicalisation, tout ce qu’on ne peut pas dire, Plon), dans lequel elle expose sans détours son regard sur ce monde clos dresse un état des lieux glaçant du milieu carcéral.
Directrice de prison pendant plus de 20 ans, Christelle Rotach, 50 ans, connaît intimement la réalité pénitentiaire : la surpopulation, la violence, les suicides, la radicalisation. Après avoir dirigé les maisons d’arrêt (Fleury Mérogis, Nanterre, Les Baumettes, La Santé) les plus sensibles de France durant vingt-deux ans, à présent inspectrice générale de la justice, elle publie un témoignage (Directrice de prison. Trafics, violence, radicalisation, tout ce qu’on ne peut pas dire, Plon), dans lequel elle expose sans détours son regard sur ce monde clos dresse un état des lieux glaçant du milieu carcéral.
Christelle Rotach interviewée par La Vie, Le Parisien et Femme actuelle
Comment devient-on directrice de prison ?
On vient à ce métier par hasard, du moins pour moi, mais on y reste par choix. Diplômée en droit et en criminologie, j’ai découvert la prison pendant mes études. J’avais peut-être une sensibilité particulière à l’enfermement, mais je n’en ai pris conscience que lors de la rédaction de ce livre avec la journaliste Delphine Saubaber, qui m’a tendu ce miroir. Quand j’avais 11 ans, une nécrose du fémur m’a obligée à rester immobilisée sur un chariot de fer pendant près de un an, avec des poids tirant sur mes jambes. Je suis restée prisonnière de mon corps et de ce chariot. Je l’ai vécu comme une punition et une injustice. La douleur vécue ou observée dans le centre où je suis restée avec d’autres enfants, bien plus gravement malades, m’a marquée et aidée à comprendre la souffrance. Donc, peut-être plus tard, celle des détenus : je suis très empathique, une éponge ! L’expérience de la maladie m’a à la fois endurcie et ouverte aux autres.
J’ai passé le concours de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire pour accompagner un ami qui ne voulait pas y aller tout seul. Et je l’ai réussi… A 26 ans, je me suis retrouvée à prendre mon premier poste aux prisons de Lyon. Les grilles qui claquent, le bruit des clés dans les serrures, les coups des détenus aux portes de leur cellule, leurs cris et les rappels à l’ordre des surveillants qui rebondissent d’un mur sur l’autre : d’emblée, j’ai été prise dans un brouhaha assourdissant qui ne m’a plus jamais quittée pendant mes vingt ans de prison.
Avec ce livre vous rompez le silence. D’habitude, vous parlez peu de votre métier.
Il est impossible de comprendre ce que nous vivons tant qu’on n’a pas passé la porte d’une prison. Et puis, je n’aime pas raconter ce qui est vraiment très noir. J’en fais mon affaire. Un directeur de prison n’est pas censé avoir des états d’âme. Il doit faire tourner la boutique. La première fois qu’on m’a demandé comment j’allais, j’avais déjà dix ans de métier. Jusque-là, personne ne m’avait posé la question, même après de gros incidents, même après mon premier suicidé.
Quelles qualités sont nécessaires ?
À la tête d’une prison, il faut gérer deux populations différentes, les surveillants et les détenus. Jouer un rôle d’organisateur et de facilitateur, être cheffe d’orchestre. Commander, mais tâcher de rester juste. Ne pas mettre d’affect avec les détenus, même si certains parfois sont touchants. Ne pas établir de hiérarchie dans la délinquance. Un directeur doit tout gérer, même des grands criminels. Il n’est pas un juge. Il ne fait qu’exécuter des décisions prises par d’autres. C’est dur. J’ai parfois été menacée, j’ai eu peur. Dans ce livre, j’ai aussi voulu faire comprendre les difficultés du métier.
Vous livrez un regard sans concession sur les prisons françaises…
Les gens fantasment sur la prison. Ils l’imaginent comme le lieu de tous les excès. C’est parfois vrai, mais c’est aussi un quotidien un peu routinier. Je voulais raconter les difficultés auxquelles nous, personnel pénitentiaire, sommes confrontés. La prison récupère ceux que notre société ne veut plus voir : criminels, fous et, de plus en plus, terroristes islamistes. Comme si l’on pouvait enfermer tous ces gens à perpétuité et être certains de ne jamais les revoir. Mais la prison n’est qu’un lieu de passage.
Nous serions assis sur un volcan qui menace d’exploser…
Les prisons sont surpeuplées. On remplit les cellules à 150 ou 180 % de leur capacité. J’ai travaillé, trop souvent, avec des bouts de ficelle. En tant que directrice, j’étais responsable de tout dans l’établissement, d’un pendu jusqu’à un oubli dans l’envoi d’une convocation, de malfaçons dans un mur jusqu’aux tensions entre détenus. Comment, dans ces conditions, donner du sens à la peine, au-delà du seul enfermement?
La gestion d’un établissement pénitentiaire s’apparente à de la sismologie : tout peut basculer à n’importe quel moment. Si un détenu n’a pas pu cantiner et qu’il se retrouve sans tabac ou sans télé, il peut mettre le feu à sa cellule ou se couper avec son rasoir jetable. L’équilibre d’un établissement pénitentiaire tient aussi à la manière dont on répartit les détenus dans les cellules. On essaye de ne pas mélanger ceux qui sont impliqués dans une procédure criminelle avec ceux relevant d’une procédure correctionnelle. De les regrouper par âge, par langue, de mettre les fumeurs entre eux. On prête attention aux infracteurs sexuels, qui sont à la fois un risque pour les autres et des cibles privilégiées. On veille à ne pas importer dans la prison les conflits extérieurs, du quartier ou même géopolitiques : par exemple, on ne met pas dans la même cellule un Somalien et un Erythréen.
La prison, c’est d’abord un univers violent ?
Oui, il existe derrière ses murs un climat général de violence. C’est la réalité des maisons d’arrêt (établissements pour les prévenus, pas encore jugés), les seuls établissements dans lesquels j’ai travaillé. C’est un univers en mouvement, où prédominent le bruit et les rapports de forces. La violence verbale, les insultes, dans les deux sens : les détenus sont violents envers les personnels, et les personnels sont violents envers les détenus. Les phénomènes de violence sont exacerbés, car on est là par contrainte. C’est frustrant de dépendre de quelqu’un pour aller et venir ou pour prendre sa douche. Il faut s’exécuter dans la minute. C’est un monde clos, qui suscite les fantasmes. S’y exercent aussi des violences psychologiques. Dans mon premier établissement, la prison vétuste de Saint-Joseph à Lyon, aujourd’hui fermée, j’ai travaillé dans un bureau sans fenêtre, aux murs décrépits et suintants, avec les rats qui circulaient dans les coursives. Cette obsolescence, c’est une violence en soi. Mais j’ai remarqué que plus les conditions sont difficiles, plus le personnel se serre les coudes. Il existe une extrême solidarité. Et les détenus aussi essayent de tenir. La violence entre détenus est aussi très problématique et répandue.
La gestion des faits de violence est la priorité numéro un de tous les établissements. Il y a d’abord la violence entre les détenus. On peut alors agir sur l’organisation de la détention. Si on a deux bâtiments, on peut séparer les catégories pénales, les communautés. On peut aussi gérer l’accès à la cour de promenade, afin que certains ne se rencontrent pas. Pour ce qui est des violences contre le personnel, on tâche de mieux former nos surveillants. On leur rappelle les gestes basiques. Par exemple, quand un détenu monte en pression, tambourine à la porte, profère des insultes, le surveillant ne doit plus lui ouvrir seul. C’est un métier difficile physiquement, et psychologiquement éprouvant. Je suis très admirative du personnel.
Quelles solutions y apporter ?
Ce problème de violence est devenu une vraie préoccupation de l’administration pénitentiaire (AP). Depuis 10 ans, elle est tenue à une amélioration, par des objectifs chiffrés : moins de viols, moins de procédures disciplinaires, davantage d’espaces de discussion, etc. Il se passe parfois en détention des choses terribles, difficiles à oublier. Comme cette affaire que j’ai vécue : un jeune homme torturé pendant six semaines par ses deux codétenus sans que le personnel s’en aperçoive, et ressorti de sa cellule défiguré : «Elephant Man» ! Il a porté plainte contre les deux codétenus, pas contre l’AP, mais il aurait pu. Son histoire m’a mortifiée, car je n’ai pas su le protéger.
En 20 ans, vous avez recensé 42 morts dans les établissements que vous gériez.
Oui, essentiellement des suicides. C’est un fléau, même si le système des codétenus de soutien, mis en place avec la Croix-Rouge, est efficace. La population carcérale est fragile. Isolée, marginalisée, avec souvent des troubles psychiatriques. Comment ne serait-elle pas exposée à un risque plus grand ? Je ne dis pas cela pour excuser ou justifier, mais pour expliquer un contexte. Mais je crois que la prison peut rester un lieu d’humanité. Et remplir sa mission de réinsertion. Ou du moins aider à lutter contre la récidive, pour que les sortants de prison ne poursuivent pas leur parcours délinquant. Dedans, on peut aider à travailler sur ce qui a manqué en société. Mais l’administration pénitentiaire ne peut pas tout : le détenu doit aussi manifester sa volonté de s’en sortir.
La surpopulation n’aide pas…
Précisons d’abord que la surpopulation n’impacte pas les établissements hébergeant des détenus condamnés à de longues peines, pour lesquels il existe un numerus clausus (un nombre maximum fixé par la loi). Les maisons d’arrêt, en revanche, accueillent tout le monde : les condamnés ayant moins de deux ans de prison à effectuer, les prévenus en attente de jugement… Ces établissements, en particulier dans les grands centres urbains (Paris, Lyon, Marseille, Lille…), sont très touchés par la surpopulation. Cela signifie deux, trois, voire quatre personnes dans des espaces conçus pour en accueillir une seule. Souvent, les cellules sont équipées de lits superposés, et on ajoute un matelas au sol. Mais ça, c’est vraiment très compliqué. Parce que la troisième personne se retrouve en situation d’infériorité par rapport aux deux autres.
Dans les maisons d’arrêt, elle est très forte, hélas ! J’ai vu ce problème s’aggraver en 20 ans. À Saint-Joseph, j’ai connu des cellules de 9 m2 où l’on mettait jusqu’à cinq détenus, trois sur des lits et deux sur des matelas. J’ai toujours essayé d’éviter les matelas par terre, en doublant les lits. Ne serait-ce que parce que celui qui dort au niveau du sol est en position d’infériorité. Mais il y a beaucoup de matelas au sol dans les maisons d’arrêt en France, car leur taux d’occupation est parfois très élevé. Depuis 30 ans, pour résoudre ce problème, on a développé des programmes immobiliers et construit 30.000 nouvelles places. On a aussi fermé les établissements vétustes et inadaptés.
Quand un surveillant ouvre la porte de la cellule, il a davantage de personnes en face de lui, c’est plus délicat. Cela signifie aussi davantage de personnes à faire bouger à chaque mouvement, avec des étages qui passent de 60 à 90, voire à 120 personnes… Et 120 détenus pour un seul surveillant, c’est démesuré. Cela pose également des problèmes pour l’accès régulier à la douche, aux parloirs…
Mais quel autre remède a-t-on imaginé ?
Aujourd’hui, on essaye de changer de paradigme : faire que la peine de prison ne soit plus la peine étalon. Il s’agit d’inciter les juges à trouver d’autres solutions, pas de vouloir fermer toutes les prisons. Ce n’est pas du laxisme ou de l’angélisme. Car à quoi cela sert-il de mettre quelqu’un en détention pour un mois ou trois mois ? Il perd son travail, son appartement, sa famille parfois, et la société y gagne quoi ? La loi de réforme pour la justice de Nicole Belloubet, garde des Sceaux, votée l’an dernier propose notamment une nouvelle peine, qui sera appliquée à partir de mars 2020 : la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE). Le bracelet électronique existait déjà, mais comme un aménagement de peine. Être en prison chez soi, c’est une véritable peine, pas une mesure douce, notamment parce qu’il faut respecter des contraintes horaires et s’auto-discipliner.
Gérer les détenus radicalisés est une autre difficulté…
Oui, un problème survenu brutalement à partir de 2015. Nous avons tâtonné pour leur prise en charge, c’est vrai. On a hésité entre les regrouper ou les disséminer. Il a fallu enfermer les auteurs d’actes terroristes et ceux qui en faisaient l’apologie. On les a vus déferler, notamment les 500 détenus de retour de Syrie. Ils ont été concentrés sur 70 établissements pouvant les accueillir. Aujourd’hui, un terroriste est d’abord évalué par rapport à sa dangerosité dans l’un des quatre quartiers d’évaluation de la radicalisation, puis est orienté vers un quartier de prise en charge de la radicalisation ou dans un quartier d’isolement s’il est très dangereux. À la Santé, le quartier pour les terroristes radicalisés se nomme le QB3 et compte une quinzaine de cellules. C’est une population carcérale très difficile à gérer, car certains sont instrumentalisés, d’autres instrumentalisent. Aux Baumettes, j’ai aussi dû gérer une affaire de surveillants radicalisés.
Il y a les islamistes, condamnés pour des faits terroristes, de l’apologie ou de la radicalisation violente. Nous n’étions pas préparés à accueillir ce public si particulier, porteur d’une haine si féroce, nous ne savons pas vraiment comment le traiter. Une fois que l’idéologie est nichée au cœur d’un cerveau, le retour en arrière n’est pas toujours possible… Nous devons au moins trouver les moyens de les empêcher de retourner d’autres détenus, fragiles et crédules.
Quels sont les profils de ces hommes ?
On rencontre tous les cas de figure. Il y a des petits jeunes un peu paumés, isolés socialement, sans ressources, avec un niveau d’études plutôt bas, un père absent et une fratrie importante. A ces jeunes, des radicaux ont proposé l’entraide, une nouvelle famille, des valeurs fortes… Ceux-là, nous essayons de les orienter vers du sport, des activités culturelles, pour rompre leur isolement social et intellectuel, avec plus ou moins de réussite. Il y a ensuite des gens qui se sont radicalisés par opportunité, pour faire des affaires, pour vendre des armes ou de la drogue. Et puis, il y a ceux qui basculent dans un autre monde, qui deviennent franchement dangereux et qu’on ne pourra, je pense, jamais récupérer.
Comment gère-t-on ce type de détenus ?
C’est un public très difficile, très éprouvant pour le personnel. Un public auquel nous n’étions pas préparés. Une réflexion globale a été engagée au niveau de l’administration. Mais comment former plus de 30 000 personnes à l’accueil d’une population comme celle-là? C’est énorme.
Comment choisissez-vous les surveillants chargés de s’occuper de ces détenus-là ?
Ils doivent être volontaires. Dotés d’une vraie capacité de détachement, être aguerris à l’observation et ne pas faire d’amalgame entre le musulman qui pratique sa religion, même de manière rigoriste, et celui qui prône la violence. Ils doivent être à l’aise avec les règles de sécurité, mais être en même temps capables d’empathie. Il ne s’agit pas d’ouvrir et de fermer les portes en étant complètement figé. Quelles que soient nos propres convictions, nous avons un devoir de neutralité par rapport aux publics pris en charge.
Vous sentez-vous mieux outillée aujourd’hui ?
Oui, même si nous n’avons pas encore toutes les réponses adéquates. Des programmes de gestion du personnel, et des programmes de suivi des individus radicalisés ont été créés, ainsi que des quartiers de prise en charge de la radicalisation, les QPR. Ces quartiers sont isolés des autres, et renforcés en sécurité pour éviter la contagion et le prosélytisme. A leur arrivée, les détenus terroristes sont évalués durant six semaines, puis, selon leur degré de dangerosité et d’influençabilité, placés soit en QPR, soit à l’isolement, soit en détention normale. Nous travaillons avec des éducateurs et des psychologues spécialisés dans cette prise en charge. Nous préparons aussi les sorties avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation. Car beaucoup de ces détenus sortiront.
Il y a aussi beaucoup de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques graves en prison…
Les malades mentaux sont de plus en plus nombreux. Si 30% environ des détenus présentent déjà un trouble psychiatrique au moment où ils entrent en prison, d’autres basculent du fait de leur enfermement. Nous accueillons des personnes qui ne trouvent leur place ni dans la société ni à l’hôpital tel qu’il est pensé aujourd’hui. Et la prison aggrave leurs troubles, car l’enfermement est contre nature. Les surveillants prennent ça de plein fouet.
En vingt-deux ans de carrière, trouvez-vous que la prison a beaucoup changé ?

Christelle Rotach (de g. à dr.), inauguraient, le 12 avril 2019, la prison de la Santé rénovée, à Paris. Sipa/Nicolas Messyasz
La plupart des établissements pénitentiaires avaient été construits entre le XIXe siècle et le début du XXe siècle, ou aménagés dans d’anciennes casernes ou d’anciens couvents. Nombre d’entre eux étaient devenus trop vétustes. Mais depuis la fin des années 1980, l’administration pénitentiaire a engagé des programmes immobiliers majeurs. Une transformation dont on n’a pas toujours conscience. Nous sommes passés de 36 000 places vétustes à 56 000 places, dont une grande partie très modernes. C’est colossal. Dans les bâtiments les plus récents, il y a une douche dans les cellules. C’est un progrès fantastique. Le téléphone est accessible à tous les détenus, avec des cabines dans les espaces communs, et désormais dans les cellules. C’est décisif pour le maintien des liens familiaux et l’apaisement en détention. Outre la télévision, il y a maintenant des réfrigérateurs et des plaques chauffantes dans la plupart des cellules. Cela permet aux détenus de se préparer leurs propres repas. L’accueil des arrivants a aussi beaucoup évolué, et répond désormais à des normes européennes.
En 22 ans, j’ai vu la population changer. Les bandits « à l’ancienne », issus du crime organisé, n’occupent plus le devant de la scène. Ceux qui provoquent le plus d’incidents au quotidien, ce sont les jeunes caïds des cités. Ils entrent en prison avec une forme de fierté, comme si c’était « la place où être » pour renforcer leur statut.
Tous les établissements que vous avez dirigés souffraient de surpopulation. Comment cela se traduit-il concrètement au quotidien ?
Précisons d’abord que la surpopulation n’impacte pas les établissements hébergeant des détenus condamnés à de longues peines, pour lesquels il existe un numerus clausus (un nombre maximum fixé par la loi). Les maisons d’arrêt, en revanche, accueillent tout le monde : les condamnés ayant moins de deux ans de prison à effectuer, les prévenus en attente de jugement… Ces établissements, en particulier dans les grands centres urbains (Paris, Lyon, Marseille, Lille…), sont très touchés par la surpopulation. Cela signifie deux, trois, voire quatre personnes dans des espaces conçus pour en accueillir une seule. Souvent, les cellules sont équipées de lits superposés, et on ajoute un matelas au sol. Mais ça, c’est vraiment très compliqué. Parce que la troisième personne se retrouve en situation d’infériorité par rapport aux deux autres.
Et pour les surveillants ?
Quand un surveillant ouvre la porte de la cellule, il a davantage de personnes en face de lui, c’est plus délicat. Cela signifie aussi davantage de personnes à faire bouger à chaque mouvement, avec des étages qui passent de 60 à 90, voire à 120 personnes… Et 120 détenus pour un seul surveillant, c’est démesuré. Cela pose également des problèmes pour l’accès régulier à la douche, aux parloirs…
Albert Camus disait : «On juge une société à l’état de ses prisons.»
Hélas ! c’est exact. La prison, c’est le miroir dans lequel la société ne veut pas se voir. Mais je crois qu’aujourd’hui on se préoccupe davantage de nos établissements qu’hier. En 2000, Véronique Vasseur, médecin-chef à la Santé, a publié un livre qui a eu beaucoup de retentissement (Médecin-chef à la prison de la Santé, Le Cherche Midi). Son témoignage sur le quotidien carcéral a débouché sur deux commissions d’enquêtes parlementaires. On a enfin accepté de regarder ce qui se passait derrière ces murs opaques. À présent, mon livre ne fait pas de vagues. La vision de la prison n’est plus la même, les gens savent. Il faut l’améliorer, bien sûr. La Santé est le dernier établissement que j’ai dirigé, après sa réouverture en janvier 2019. Sa rénovation montre le progrès : la lumière pénètre davantage, par exemple par des verrières. Les téléphones portables y sont brouillés – et cela devrait être le cas partout bientôt. Ces téléphones, comme la drogue, très présente, hélas ! entrent clandestinement en détention. En revanche, à la Santé, il y a maintenant des points-phones dans les cellules : les détenus peuvent appeler leurs proches quand ils le veulent. C’est un progrès formidable, qui devrait aussi être généralisé.
Vous ne connaissiez jamais de repos. A tout moment, vous pouviez être appelée en urgence…
Pendant toutes mes années à travailler en prison, je ne quittais jamais mon téléphone. Jamais, jamais, jamais. Quand j’allais prendre ma douche, il restait à proximité. Même lorsque je prenais des congés, je l’emportais avec moi. Il m’est arrivé de rentrer illico.
Apprend-on sur les bancs de l’école à gérer des incendies allumés par des détenus dans leur cellule, des immolations, des bagarres dans la cour de promenade entre bandes rivales des quartiers, des tentatives d’étranglement sur les surveillants ? Non. Je me suis donc initiée à l’univers pénitentiaire sur le tas. Un jour, un détenu atteint d’un trouble psychiatrique m’a décoché un uppercut au visage et m’a cassé le nez. Du haut de mes 26 ans, je me suis demandé si j’aurais le courage de revenir le lendemain. Je suis revenue…
Année après année, j’ai passé mes journées au contact de la misère humaine, du meurtre, de la folie, des trafics, du viol, de la pédophilie, du terrorisme. Dix ans après mes débuts, alors que j’étais directrice adjointe de la prison de Fleury-Mérogis, j’ai vécu l’un des pires drames de ma carrière. Un jeune détenu de 19 ans a été retrouvé par un surveillant, roulé en boule sous sa couverture et défiguré. Cela faisait six semaines que ses deux codétenus le torturaient sans que personne ne se soit rendu compte de rien. Après l’avoir fait hospitaliser en urgence, je suis sortie de sa cellule mortifiée, comme si ce gamin était le mien et que je n’avais pas su le protéger.
En tant que directrice de prison, je me suis souvent sentie seule, condamnée à faire avec des bouts de ficelle. Mettre trois détenus dans une cellule, ça n’est satisfaisant pour personne. En théorie, la prison sert à faire ressortir les détenus un peu meilleurs qu’ils y sont entrés. En pratique, notre but est souvent plus modeste : que la boutique tourne sans trop d’incident, que cette poudrière en puissance ne s’enflamme pas.
Comment tient-on face à tant de noirceur ?
Je lis. Je marche beaucoup. Avec mon chien. Ça rend la charge mentale plus supportable. Mais, à certains moments, c’est plus compliqué. A deux reprises, j’ai été au bord du burn-out. Quand j’étais à Nanterre, je partais tous les week-ends, je quittais la ville. J’avais besoin de couper physiquement. Ça a été très difficile pendant six mois. La deuxième fois, c’était aux Baumettes, à Marseille. Je n’en pouvais plus.
Votre foi en l’homme a-t-elle été ébranlée ?
Elle a pu vaciller, mais je l’ai conservée. Ce que j’ai le plus de mal à encaisser, ce sont les terroristes. Je n’imagine pas qu’un être humain puisse faire des trucs pareils, et pourtant si. Mais je crois que l’homme peut devenir meilleur.
En tant que directrice de prison, je me suis souvent sentie seule, condamnée à faire avec des bouts de ficelle. Mettre trois détenus dans une cellule, ça n’est satisfaisant pour personne. En théorie, la prison sert à faire ressortir les détenus un peu meilleurs qu’ils y sont entrés. En pratique, notre but est souvent plus modeste : que la boutique tourne sans trop d’incident, que cette poudrière en puissance ne s’enflamme pas.
A l’heure où je quitte la prison pour une nouvelle affectation professionnelle hors les murs, certains jolis souvenirs me reviennent aussi bien sûr en mémoire. Quelle fierté par exemple quand venait l’heure de remettre des diplômes à des détenus ayant décidé de se lancer corps et âme dans les études ! Quelle joie d’apprendre qu’un adolescent des quartiers nord de Marseille, une fois sorti de la prison des Baumettes, a choisi avec son éducateur et ses parents de partir vivre ailleurs, dans une petite ville où il mène une existence loin de la délinquance et des trafics. Avoir réussi à redonner du souffle à quelques-uns me suffit pour y croire encore. Pour me dire que j’ai fait du mieux que j’ai pu. »
Sources: La Vie, Le Parisien et Femme actuelle